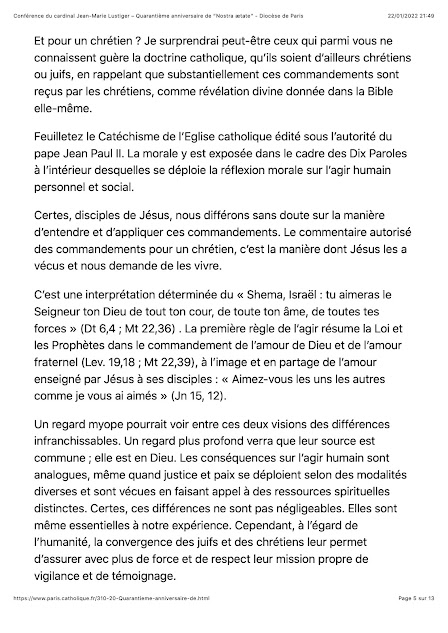Bonjour et bienvenue sur le blog de l'association. Il s'agit d'une Association privée de fidèles (Église Catholique) érigée en 1997 par Mgr. Jean-Marie Lustiger. Vous y trouverez les nouvelles d'intérêt général (conférences, articles). Les invitations aux rencontres mensuelles continueront de vous être transmises personnellement. Bien amicalement. Le modérateur.
vendredi 28 janvier 2022
samedi 22 janvier 2022
Un théoricien précoce de l'enracinement juif du christianisme
Un théoricien précoce de l’enracinement juif du christianisme
Le P. Louis Bouyer (1913-2004) est un des théologiens majeurs du XXe siècle, tenu par les Jean Daniélou, Henri de Lubac et Hans Urs von Balthasar pour leur pair. Auteur de quelque cinquante livres constamment réédités, dont une monumentale synthèse en une triple trilogie, enfermé dans aucune spécialisation académique, pionnier du renouveau liturgique et de l’œcuménisme, promoteur de la notion de spiritualité (qu’il a définie, pour la distinguer de la dogmatique et de la morale, comme « les réactions que les objets de la croyance suscitent dans la conscience religieuse, au niveau des exercices aussi bien que des expériences »[1]), pasteur protestant (luthérien) fasciné par l’orthodoxie orientale avant de devenir prêtre de l’Oratoire (comme John Henry Newman qu’il s’employa à faire mieux connaître), premier présentateur en France (dès 1954) de son ami J.R.R. Tolkien et proche de Julien Green, déclencheur de la « vocation » de l’acteur Philippe Noiret qui lui rendit publiquement hommage à plusieurs reprises, professeur du séminariste Jean-Marie Lustiger qui n’a jamais oublié l’approche libératrice qu’il enseignait de l’exégèse[2], il a été paradoxalement peu reconnu ces dernières décennies dans les milieux cléricaux en France. La raison en est sans doute l’implacable férocité de ses critiques[3] de la naïveté, qu’il jugeait calamiteuse, des enthousiasmes postconciliaires, alors que lui-même avait pourtant été un des principaux artisans de la deuxième prière eucharistique du nouveau missel, était salué comme féministe en dehors de l’Église[4] et intégrait dans ses travaux la « modernité » de la psychanalyse, des sciences, de l’ethnologie, de la littérature profane et de l’architecture. Avant de se retirer à l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille (où il avait été reçu dans l’Église catholique en décembre 1939) puis, lorsque sa santé s’altéra, chez les Petites Sœurs des Pauvres à Paris, il termina donc sa carrière dans les universités américaines et argua de sa mauvaise réputation pour dissuader Paul VI, qui le tenait en haute estime et le nomma à la première Commission théologique internationale, de le charger la pourpre cardinalice.
Un des aspects constitutifs de l’œuvre de Louis Bouyer est l’importance capitale qu’il reconnaît au judaïsme dans la théologie, la spiritualité, la liturgie et la culture chrétiennes. On en prendra pour preuve trois seulement de ses livres (même si, en maintes autres occasions, il s’attache à rappeler l’enracinement vital du christianisme dans la tradition biblique[5]).
1. Entre mysticisme et légalisme
Sa monumentale Histoire de la spiritualité chrétienne[6] s’ouvre significativement par un premier chapitre substantiel (37 pages) intitulé : « Le legs du judaïsme ». Il y est affirmé d’emblée que le sujet de toute l’étude qui commence ne peut être traité qu’à partir de la spiritualité juive « telle qu’elle était aux origines chrétiennes »[7].
Cette précision marque une limite : l’auteur s’intéresse d’abord au judaïsme d’il y a deux mille ans et non à ce qu’il est devenu depuis, ni (par conséquent) aux relations rétablies et développées récemment. Cela signifie cependant que, s’il ne prend pas en directement compte les évolutions, nouveautés et événements dans les communautés israélites postérieures aux tout premiers siècles de l’ère chrétienne, il souligne bien les permanences et les continuités qui permettent aujourd’hui un rapprochement ou, comme disait le cardinal Lustiger, des « retrouvailles ».
Il montre en effet que certaines orientations qui prennent forme à peu près au temps de Jésus survivent séparément mais parallèlement dans le judaïsme et dans l’Église. Si les habouroth, ces communautés juives des ères asmonéenne et hérodienne, dont Qumrân est un bel exemple et qui préfigurent le monachisme chrétien, avec notamment le vœu de chasteté ou du moins de célibat[8], disparaîtront par la suite du judaïsme, d’autres orientations subsisteront des deux côtés. C’est le cas du mysticisme des « spéculations haggadiques, [...] coupables aux yeux des maîtres de la halakhad’avoir frayé les voies du christianisme. [...] Tout cela, resté sous-jacent à l’âme juive, réapparaîtra subitement dans les poussées périodiques de la gnose cabalistique ou dans la ferveur tant de fois renouvelée des groupes de hassidim ». Et de citer en note à ce propos Gershom Scholem (1897-1982)[9], avant de présenter ce mysticisme « gnostique » comme un trait commun aux chrétiens et aux Israélites sous tous les climats au fil des siècles[10].
Symétriquement, la halakha est définie sans hésitation comme « une interprétation casuistique de la Loi ». Alors que l’on aurait attendu « rabbinique », l’adjectif « casuistique » suggère une parenté entre « l’époque talmudique [du] légalisme d’origine pharisaïque ayant définitivement supplanté la caste sacerdotale »[11] et les XVIIe-XVIIIe siècles où la théologie morale des jésuites est combattue par le rigorisme janséniste puis par l’anticléricalisme naissant.
Le P. Bouyer se garde toutefois d’opposer mysticisme et formalisme au sein du judaïsme, de même qu’il se refuse à séparer ascèse et extase dans la spiritualité chrétienne :
Le rôle des scribes, à cette époque pas plus qu’aux autres, ne se bornait nullement à la tâche strictement conservatrice qu’on est toujours tenté de leur attribuer. Pas davantage leur horizon n’était-il tout entier enfermé dans une casuistique mesquine. [...] Le scribe juxtapose à la halakha et ses préceptes minutieux, qui ne nous semblent qu’une casuistique, la haggadah et ses créations si libres qu’elles nous paraîtraient fantastiques[12].
C’est bien avant l’apparition du christianisme, « à partir de l’exil » en Mésopotamie, lorsque les sacrifices au Temple de Jérusalem deviennent impossibles, que s’enclenche « la polarisation croissante de la piété israélite [...] sur le culte synagogal, c’est-à-dire principalement la lecture méditée de la Bible et une prière nourrie de cette lecture ». Il y a là une orientation apparemment irréversible jusqu’à nos jours, dans la diaspora et même en cas de retour sur la terre d’Israël, où une intériorisation du culte s’articule avec les multiples prescriptions dans la vie quotidienne :
La piété synagogale sera ce que l’on peut appeler aussi bien la spiritualisation du rite sacrificiel ou la ritualisation de toute l’existence. [...] Elle vise à faire de toute action de l’Israélite pieux une action sacrée, proprement liturgique [..., à faire] prendre et exprimer une attitude intérieure de foi reconnaissante en la Parole créatrice, source de tout bien, à propos de tout[13].
On a donc ici, à défaut de dialogue direct, un effort encore rare au début des années 1960 pour comprendre et expliquer aux chrétiens le judaïsme non seulement d’il y a deux mille ans et plus, mais encore la perpétuation dialectique de ses formes et contenus jusqu’à l’époque contemporaine. L’enracinement du christianisme naissant dans cette « piété synagogale » qui reste une constante historique est également souligné dans les cinq chapitres suivants, consacrés à Jésus lui-même (avec quelques pages sur la figure presque « classiquement » prophétique du Baptiste) et aux écrits du Nouveau Testament, en relevant la tonalité foncièrement biblique du Magnificat de Marie ainsi que les ressemblances entre la première Église de Jérusalem et les habouroth, avec une insistance sur le souci omniprésent d’orthodoxie juive, particulièrement dans l’Épître aux Hébreux, dans la Première lettre de Pierre et chez Paul, ce pharisien qui sait le grec, apôtre des « Gentils ».
La fin du premier chapitre se concentre justement sur un autre juif hellénisé de la même période, mais qui n’a vraisemblablement jamais entendu parler de Jésus : Philon d’Alexandrie[14]. Il est présenté comme le prototype de l’inculturation que réussit le judaïsme répandu pratiquement partout sans jamais se dissoudre dans aucune civilisation, mais aussi de la diaspora qui suscite, dès avant la destruction du Second Temple, la religiosité synagogale. C’est à nouveau là une manière de reconnaître indirectement la place et le rôle des fils d’Israël dans les sociétés d’aujourd’hui :
On persiste à le [Philon] présenter comme un philosophe grec, vaguement éclectique, qui aurait tout au plus revêtu d’images bibliques, par le procédé fallacieux de l’allégorie, une pensée étrangère au judaïsme, à part quelques notions bibliques, elles-mêmes transposées en concepts philosophiques. Il serait difficile de constituer un plus parfait contresens, encore qu’il soit vrai que Philon lui-même s’est employé dans une large mesure à créer l’équivoque. Cette équivoque, d’ailleurs, est celle que les plus intelligents des Juifs n’ont cessé de créer : s’assimilant d’une façon stupéfiante la langue, la culture, les usages superficiels des civilisations les plus diverses, mais gardant derrière cela, dans une fidélité vraiment extraordinaire, non seulement leur foi, mais leurs mœurs, leur conception religieuse, si différenciée, de toute la vie[15].
L’exégèse « allégorique » de Philon, note le P. Bouyer, « doit bien plus au midrash du judaïsme palestinien qu’à aucune allégorie néopythagoricienne ou stoïcienne », et le christianisme la reprendra : Origène en sera un héritier deux cents ans plus tard toujours à Alexandrie, allant jusqu’à consulter des rabbins[16]. Et la communauté israélite à laquelle appartient Philon est décrite dans une situation analogue à celle des chrétiens qui, selon l’Épître à Diognète, dans la même ville et peu avant Origène, sont « dans le monde sans être du monde » : déjà du temps de Philon, « les Juifs sont chez eux, et pas comme des citoyens de seconde zone, dans la cité hellénistique [sans que] pour cela ils doivent modifier leurs pratiques religieuses, l’essentiel de leur genre de vie, [ni] altérer leurs croyances »[17].
2. De l’eucharistie juive à l’eucharistie chrétienne
Quelques années à peine après son le premier volume de son Histoire de la spiritualité chrétienne où il commence par l’enracinement dans le judaïsme, le P. Bouyer en reprend et développe un aspect évidemment crucial pour la théologie non moins que pour la spiritualité, dans un livre qu’il considérait comme un des plus importants qu’il ait publiés, et en tout cas comme celui qui lui avait demandé le plus de travail tout en le passionnant peut-être davantage qu’aucun autre, en raison d’un enjeu décisif pour le renouvellement ou le ressourcement de l’Église dans le contexte conciliaire et postconciliaire de la fin du XXe siècle. Il s’agit d’une étude de près de 500 pages sur les prières eucharistiques[18].
Il en a lui-même résumé la thèse centrale : « Les prières eucharistiques chrétiennes se sont [...] élaborées à partir des berakoth : des “bénédictions” de la synagogue ». Il s’agit de « la réponse suscitée chez le croyant par la Parole divine reçue avec foi », berakah étant traduit par eucharistia dans la version grecque de la Bible, la Septante[19].
Le P. Bouyer justifie d’abord l’appellation « eucharistique » qu’il a déjà donnée au début de son ouvrage sur la spiritualité chrétienne aux berakoth juives du temps de Jésus. Il vaut la peine de citer ici assez longuement, en le resserrant encore, le résumé qu’il a fait là par avance de sa démonstration plus élaborée et plus savante dans son étude sur non pas l’ensemble de la liturgie de la messe, mais « ce que l’on appelle en Orient l’anaphore, unissant inséparablement les équivalents de notre préface et de notre canon »[20]. La bénédiction est
une prière où l’on se livre à la grâce divine en s’abandonnant aux volontés de Dieu connues par sa Parole. [...] Cette sacralisation de toute la vie pénétrée de “connaissance” [gnose] se trouve un nouveau foyer rituel qui tend évidemment à remplacer les anciens sacrifices. Et c’est le repas commun, le repas de la famille juive rassemblée pour un sabbat ou une fête solennelle, et plus encore le repas de communauté de ces habouroth dont Qumrân nous a révélé l’importance. Mais, pour l’Israélite mangeant les fruits de la Terre sainte, [...] ce qu’il mange est béni [...] comme le fruit de l’action salvatrice par laquelle Dieu l’a soustrait de l’esclavage impie de l’Égypte et transporté au saint royaume de son amour. [... Le] repas de communauté devient une véritable anticipation du banquet messianique. [...] Alors, après une suite de bénédictions rituelles sur tous les plats, sur tous les actes de ce banquet, à commencer par la fraction du pain accomplie solennellement par celui qui préside, la grande bénédiction de la coupe terminale synthétise toute cette spiritualité juive préchrétienne que nous pouvons déjà nommer eucharistique[21].
La question de savoir « si le dernier repas de Jésus avec les siens fut ou non le banquet pascal » est alors balayée d’un revers de main, « car elle se concentre sur un point secondaire »[22]. Pour citer à nouveau un passage substantiel :
Ce n’est à aucun des détails propres au repas pascal que Jésus a attaché l’institution eucharistique de la Nouvelle Alliance, [... et] seulement à ce que le repas de la Pâque avait de commun avec tout repas, c’est-à-dire le rite de la fraction du pain au début, [et] celui de la grande action de grâce sur la coupe de vin mêlé d’eau à la fin. [...] C’est ce qui a permis à l’eucharistie chrétienne, sans qu’il y eût jamais de problème, d’être célébrée aussi souvent qu’on le voudrait, et pas seulement une fois l’an. Si intéressante que soit la signification de l’agneau pascal pour comprendre la mort du Christ, ce n’est donc pas du rite de sa manducation, ni à plus forte raison de rites secondaires, comme celui des azymes ou des herbes amères, qu’il faut partir pour comprendre à sa source la prière eucharistique chrétienne. C’est du pain rompu au commencement du repas, de la coupe partagée à la fin des bénédictions qui, traditionnellement, y étaient liées[23].
Quant à la prescription de perpétuer ces rites (« Faites ceci en mémoire de moi »), il ne faut pas non plus, dit le P. Bouyer, y voir une invention totale, inspirée à Jésus uniquement par le pressentiment de sa fin prochaine et par un souci pédagogique qu’on se souvienne de lui. Le mémorial n’est
nullement un acte psychologique [...] de retour sur le passé, mais une réalité objective destinée à rendre perpétuellement actuel devant Dieu, pour Dieu lui-même, quelque chose ou quelqu’un. [...] Cette conception [...] est elle-même enracinée dans la Bible. [... C’]est non seulement un élément rituel essentiel de certains sacrifices, mais ce qui donne la signification finale de tout sacrifice, et de celui de la Pâque éminemment. C’est une institution [...] établie par Dieu, donnée et imposée par lui à son peuple, pour perpétuer à jamais ses interventions salvatrices. Non seulement le mémorial assurera subjectivement les fidèles de leur efficacité permanente, mais d’abord il assurera celle-ci, comme par un gage qu’ils pourront et devront lui représenter, gage de sa propre fidélité[24].
L’incontestable et considérable originalité qui, au travers de rites existants et préservés, démarquera du judaïsme le christianisme réside dans des additions quantitativement minimes : lorsque les « paroles de Jésus après la bénédiction et la fraction du pain vont à la fois annoncer le sens sacrificiel de sa mort et définir comment il donnera sa chair non seulement pour la vie du monde (sur la Croix), mais en nourriture de vie pour les siens (dans leurs banquets eucharistiques) » ; puis lorsqu’il présente le vin comme « son sang répandu pour la nouvelle Alliance » ; et enfin lorsque c’est de ce qu’il accomplit et même de sa personne qu’il demande de faire désormais le mémorial, affirmant ainsi implicitement mais nettement sa divinité. Lors de leurs célébrations eucharistiques, les chrétiens annoncent ou proclament « non pas d’abord au monde, mais à Dieu, [les événements du triduum pascal] dont ce “rappel” est pour lui-même le gage de sa fidélité à les sauver »[25].
La suite est simplement une revue patiente et détaillée de la formation et des transformations des prières eucharistiques chrétiennes jusqu’aux nouveaux canons de la messe après Vatican II, en passant en revue les traditions patristiques, médiévales, modernes et contemporaines (y compris au sein du protestantisme dans ces deux dernières périodes de l’histoire). « Les premières formules de l’eucharistie chrétienne, à l’imitation de ce que le Christ lui-même avait fait, ne seront que des formules juives, appliquées, par quelques mots ajoutés, à un contenu nouveau, que tout en elles préparaient »[26]. Et tout s’enchaîne à partir de là, avec d’un côté les évolutions du culte synagogal pour se distinguer du christianisme naissant[27], et de l’autre, au sein de l’Église primitive puis triomphante, des adjonctions non point improvisées (si elles sont fidèles) ni empruntées à d’autres religiosités (quelles que soient les inculturations et les tentations de retour au paganisme), mais inspirées par la Parole de Dieu à laquelle toute eucharistie, comme il a déjà été indiqué, est une réponse.
Cette compréhension de l’anaphore ne vient pas plus ex nihilo au P. Bouyer que l’eucharistie chrétienne n’« a surgi par une sorte de génération spontanée, sans père ni mère comme Melchisédech »[28]. Il raconte que ses recherches furent motivées pendant ses études (protestantes) par la découverte émerveillée d’une compilation anglaise, faite au XIXe siècle, d’anciennes prières eucharistiques[29]. Dans ses investigations, s’il s’écarte de dom Odo Casel, bénédictin allemand qui a pourtant été pour lui un guide dans l’intelligence de la liturgie[30], parce que ce dernier cherche non pas dans le judaïsme mais « dans les rites païens les plus incongrus les antécédents du mystère du culte chrétien[31] », il reconnait sa dette envers notamment Edmund Bishop[32], Anton Baumstark[33], David Hedegard[34], dom Bernard Botte[35], Joachim Jeremias[36], dom Gregory Dix[37] et Max Thurian[38].
3. Israël et l’Église
De même, ce n’est pas en terrain inexploré qu’à la fin de la même décennie, le P. Bouyer s’aventure pour approfondir et théoriser, dans le volet sur l’Église de sa grande synthèse théologique, les perspectives ouvertes avec ses travaux sur les sources juives de la spiritualité et de l’eucharistie chrétiennes[39]. Il se réfère au P. Gaston Fessard et à Nostra aetate (1965)[40] pour l’interprétation-clé de saint Paul en Romains 9-11, et tacitement au P. Jean Daniélou lorsqu’il parle du judéo-christianisme[41]. Plus indirectement encore à ce sujet, c’est, en anticipation cette fois et non plus en dette à des prédécesseurs, presque dix ans avant la retraite prêchée aux religieuses du Bec Hellouin par son ancien étudiant Jean-Marie Lustiger et plus de trente ans avant la publication du texte dans La Promesse[42], l’affirmation que l’Église des païens baptisés a besoin que ses racines restent vives, ce qui suppose la vitalité, l’écoute et, si nécessaire, le soutien non seulement du judaïsme, mais encore de « l’Église issue de la circoncision » (Ecclesia ex circumcisione)[43].
De ces quelques pages denses, on peut tirer un certain nombre de formulations qui donneront une idée d’une pensée dont toutes les implications n’ont sans doute pas encore été prises en compte.
De Romains 9-11, le P. Bouyer retient
les points les plus saillants. Le premier est que l’Église des « Gentils » ne subsiste que comme une greffe sur le tronc d’Israël. Le second est [...] que « Dieu n’a pas rejeté son peuple », car « ses promesses sont sans repentir ». Le troisième est que, de même que le rejet apparent d’Israël a été l’occasion pour les « Gentils » d’accéder à la « filiation d’Abraham », pareillement, quand « la plénitude des Gentils » aura été accueillie par l’Église [...], alors, « tout Israël sera sauvé »[44].
De cette dernière vision paulinienne est tirée un peu plus loin (juste après la section d’un peu plus de cinq pages intitulée « L’Église et le peuple juif » au chapitre XII du livre) une leçon inattendue et qui donne à réfléchir : c’est que les chrétiens sont envoyés en mission auprès non pas des Juifs, mais des païens. Il faut en effet que tous les non-Juifs soient d’abord évangélisés et intègrent l’Église pour que le dessein de Dieu soit achevé et que l’infidélité d’« une partie d’Israël [...] obtienne miséricorde »[45]. C’est pourquoi le Juif Paul va prêcher aux « Gentils », non par « quelque dédain de ses frères en judaïsme », mais dans « l’espoir [...] de hâter le moment de leur conversion. D’où son cri : “Malheur à moi si je n’évangélise pas !” »[46].
Pour revenir aux deux premiers points dégagés de l’analyse du mystère d’Israël dans l’Épître aux Romains, le P. Bouyer développe plusieurs conséquences du fait que Jésus était – et reste ! – juif, et même, en son eucharistie qui récapitule et actualise en quelque sorte toute l’œuvre de Dieu, le « Juif parfait », l’« accomplissement » du judaïsme, c’est-à-dire de la promesse faite à Abraham d’une postérité rassemblant « toutes les nations »[47] :
L’Église [...] est le Corps du Christ, mais ce Corps où l’insère plus profondément chaque célébration eucharistique est le corps d’un Juif en qui tout Israël trouve son accomplissement. Le sang dont la communion est en nous comme la source vive de la vie éternelle [...] est le sang d’Abraham et de David[48]. [...]
Mais ce n’est pas tout : [...] le principe de cette universalisation du Peuple de Dieu dans l’Église n’est point [... un] reniement de la part du Christ de son particularisme juif, mais [...] un accomplissement transfigurant de celui-ci. En Jésus, [...] c’est tout le judaïsme qui a été crucifié, mais il fallait les blessures de Jésus pour que le sang divin qui en coula communiquât à l’humanité entière le pouvoir d’avoir part à une résurrection qui est d’abord celle du Juif par excellence, du Juif parfait : Jésus de Nazareth. Greffés sur la mort de Jésus par le baptême, c’est enfin de compte sur le tronc de Jessé que nous sommes greffés. [...]
[Il s’ensuit] qu’il n’est rien [...] dans les institutions fondamentales et permanentes, parce que constitutives, de l’Église qui ne soit juif dans sa source. [...] La Parole de l’Évangile, telle que le Christ l’a proférée, telle que les apôtres l’ont élucidée, est entièrement tissée non seulement de la Parole écrite de l’Ancien Testament, mais de son vivant commentaire dans la tradition juive[49]. [...]
Tout l’Ancien Testament est si peu passé pour le Nouveau que chaque chrétien comme toute l’Église ne peut entrer et progresser dans le mystère du Christ qu’en repassant comme en raccourci, en une série de transpositions successives, par toute l’histoire d’Israël[50].
Finalement, le judéo-christianisme, défini par le P. Daniélou comme « celui des chrétiens venus du judaïsme, mais aussi de païens convertis » et non seulement « de la communauté de Jérusalem dominée par [saint] Jacques » et donc plus large[51],
comme l’a reconnu saint Paul, comme saint Pierre l’avait sans doute pressenti avant lui[52], [s’il] ne peut être la seule forme du christianisme, [...] demeure cependant à jamais sa forme génératrice, à laquelle les autres toujours devront se ressourcer[53].
De cette perspective, héritée donc des saints Pierre et Paul bien en amont du P. Daniélou, est tirée une conclusion qui mérite d’être soulignée pour deux raisons. D’une part en effet est exprimé là le besoin ou le manque auquel, six ans plus tard et de façon sans doute indépendante, répondra la refondation des monastères d’Abou Gosh chers au P. Lustiger. Et il y a là d’autre part la prise de risque d’une prévision eschatologique d’un mysticisme presque lyrique[54] :
C’est donc une infirmité pour l’Église que le judéo-christianisme, duquel elle est née et dont elle ne peut s’affranchir sans s’aliéner elle-même, en fait, ne subsiste plus en elle qu’à l’état de traces. On peut croire qu’elle n’atteindra au stade ultime de son propre développement qu’en le retrouvant, pleinement vivant en elle. [...]
Nous pouvons peut-être entrevoir comment cela se produira en observant comment le prophétisme de l’Ancienne Alliance, déjà une première fois, n’a culminé dans l’Apocalypse où elle s’achève et ne s’ouvre à la Nouvelle qu’après avoir accueilli et refondu la sagesse païenne[55]. De même, inclinerait-on à croire, la fidélité d’Israël à la Torah, qui semble aujourd’hui arrêtée sur elle-même, mais qui pourtant reste tendue par une invincible espérance, quand tous les empires et cultures successives de la gentilité auront apporté leur interprétations passagères et leurs réalisations inachevables à l’Évangile, s’ouvrira enfin à leur témoignage pour en lier la gerbe dans un nouveau judéo-christianisme[56].
Ainsi l’Église des derniers temps ne serait-elle ni une Église simplement juive où les Gentils se confondraient, [...] ni une Église des Gentils où survivraient seulement quelques Juifs convertis et eux-mêmes plus ou moins déracinés, mais cette « Église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux[57] » : elle serait « le sein d’Abraham[58] » s’élargissant pour recueillir, en ce Fils unique où sa paternité s’accomplit, « tous les enfants de Dieu dispersés[59] »[60].
En attendant, « la survie religieuse du judaïsme devrait paraître providentielle aux chrétiens » :
Depuis Origène et saint Jérôme, en passant par André de Saint-Victor[61], jusqu’à nos jours, [...] à travers tout le déroulement de l’histoire, les chrétiens éprouvent sans cesse la nécessité de recourir à cette tradition toujours survivante du judaïsme. Pour se renouveler eux-mêmes dans l’intelligence de l’Évangile et de toute la tradition chrétienne, il leur faut rafraîchir toujours à nouveau leur perception de ce qui en demeure la source première[62].
Ce qui amène le P. Bouyer à revenir sur le deuxième « point saillant » qu’il retient en citant saint Paul s’adressant au païen baptisé : « Ce n’est pas toi qui portes la souche, c’est elle qui te porte »[63]. Si « les promesses sont sans repentir », cela signifie qu’« Israël, même s’il a été devancé par les païens dans sa reconnaissance et l’acceptation de ce qui devait être sa propre plénitude, y demeure à jamais destiné »[64].
*
Ce théologien français atypique[65] ne s’engagea pas dans le rapprochement postconciliaire entre chrétiens et juifs, même si, notamment pour son Eucharistie, il entra en relation avec des rabbins, mais aux États-Unis où il résidait le plus souvent[66]. Sa connaissance du judaïsme demeure livresque. Il en a découvert la fécondité (dit-il dans ses Mémoires[67]) à lecture d’un traité de Louis Gillet, le « moine de l’Église d’Orient », ex-bénédictin passé à l’orthodoxie, dont il avait fait connaissance pendant ses études à Paris pour le pastorat[68]. Sa reconnaissance d’Israël comme source vitale, non seulement historique mais toujours actuelle de la foi et de l’existence chrétiennes, semble s’être développée dans la conjonction chez lui de la culture biblique des milieux protestants de sa jeunesse et d’une passion pour la mystique de la liturgie, suscitée par le classicisme du culte luthérien puis nourrie par la fréquentation d’émigrés russes, d’anglicans catholicisants et des Pères de l’Église, tout cela lui paraissant finalement, comme déjà à Newman, ne pouvoir être intégralement vécu que dans l’Église romaine[69].
Les contributions du P. Bouyer au rapprochement judéo-chrétien sont donc théoriques et indirectes, mais elles ont participé à la création des conditions qui l’ont rendu possible du côté catholique. D’abord avec son insistance sur la place centrale et décisive des Écritures (Nouveau et Premier Testaments inséparablement) dans la prière aussi bien personnelle[70] que communautaire et sacramentelle, alors que, jusqu’au milieu du XXe siècle à peu près, les fidèles étaient découragés de mettre le nez dans la Bible et restaient donc largement ignorants de la spiritualité judaïque, présumée dépassée. Ensuite, dans un épanouissement de cette première greffe scripturaire sur « l’olivier franc »[71], l’oratorien a proposé une intégration du « mystère d’Israël » à une position-clé dans la Weltanschauung chrétienne.
Il n’était certes pas le premier. Avant lui, il y avait eu Bloy[72], Péguy[73], le P. Bonsirven[74], les Maritain[75], l’abbé Journet[76] et, parmi ses contemporains, on peut citer les PP. de Lubac[77] et Congar[78], Fadiey Lovsky[79]... Ce qui distingue le P. Bouyer, c’est que sa réflexion n’est pas motivée par une réaction face à l’antisémitisme, mais traite du judaïsme positivement, si l’on peut dire : sans avoir à défendre Israël, de l’intérieur de sa foi et pour la comprendre mieux, dans une entreprise essentiellement théologique d’approfondissement de la croyance et de la pratique chrétiennes. Il fait ainsi figure de précurseur et de pédagogue, dont le travail a coïncidé avec Nostra aetate et en a pour une part favorisé la réception, portant du fruit par exemple chez le P. Jean-Miguel Garrigues, qui fut un de ses proches[80], mais aussi grâce à l’itinéraire et la personnalité exceptionnels de son ancien élève juif baptisé Jean-Marie Lustiger[81], le tout étant magistralement assumé et dynamisé par Jean-Paul II avec l’expérience et le génie propres de celui-ci[82].
C’est la réalisation du vœu formulé dans la préface de la première édition de l’ouvrage du P. Bouyer sur la messe comme cœur du catholicisme, qui est en même temps le plus « judéo-centré » : il y confiait que « l’amitié entre les juifs et les chrétiens [est] un de nos souhaits les plus chers »[83]. Ses livres restent de précieuses ressources en un temps où la prise conscience de l’enracinement juif peut et doit encore progresser dans l’Église.
Jean Duchesne
[1] Histoire de la spiritualité chrétienne, I (ci-après HSC I), « Préface », Aubier, Paris, 1961 (1966², p. 10-11).
[2] Jean-Marie Lustiger a dit ce qu’il devait à l’enseignement du P. Bouyer : « Il [...] proposait une intelligence religieuse et théologique de l’Écriture. Sa vision rejoignait ce que je savais, mais dont je n’avais encore d’autre confirmation que ma lecture naïve de l’Écriture. Il mettait l’accent sur la continuité historique du judaïsme et du christianisme comme sur la nouveauté spirituelle de l’Évangile » (Le Choix de Dieu, de Fallois, Paris, 1987, p. 155).
[3] La Décomposition du catholicisme, Aubier, Paris, 1968 et Religieux et clercs contre Dieu, ibid., 1975.
[4] Pour Mystère et ministères de la femme, Aubier, Paris, 1976.
[5] Particulièrement dans La Bible et l’Évangile, collection « Lectio divina », Cerf, Paris, 1952, 2009², où sont reprises les conférences qui ont tant marqué le séminariste Jean-Marie Lustiger.
[6] Quatre volumes parus de 1961 à 1966 chez Aubier à Paris, avec la collaboration de dom Jean Leclercq et de dom François Vandenbroucke pour le deuxième (sur le Moyen Âge) et de l’abbé Louis Cognet pour le quatrième (sur la première moitié des « Temps modernes »). L’ensemble (resté inachevé) a été réédité au Cerf en 2011.
[7] HSC I, p. 19.
[8] HSC I, p. 33.
[9] HSC I, p. 29.
[10] HSC I, p. 33.
[11] HSC I, p. 28-29.
[12] HSC I, p. 30 et 36.
[13] HSC I, p. 42-43.
[14] Le P. Bouyer se réfère largement ici au Philon d’Alexandrie du P. Jean Daniélou (Fayard, Paris, 1958).
[15] HSC I, p. 48-49. Cette remarque s’applique bien sûr aux seuls Juifs religieux. Elle ne concerne pas deux catégories relativement récentes, que le P. Bouyer, en tant que théologien et non sociologue ou historien des idées, ne prend pas en compte : d’abord (chronologiquement) le judaïsme « laïc » de la haskalah puis du sionisme, et ensuite (à partir du milieu du XIXe siècle) la négation (pratique dans de nombreux cas de Juifs « assimilés », théorisée chez Marx ou Freud notamment et jusque chez Sartre) de la légitimité de toute spécificité juive, parfois déclarée une aliénation exemplaire.
[16] HSC I, p. 54-55. Le chapitre XII un peu plus loin (p. 338-367) est entièrement consacré à Origène (vers 185-235), tandis qu’un des précédents (IX, p. 262-291) tourne autour de saint Justin. Ce dernier est rapproché de Philon en ce sens que d’une part « on ne doit pas tellement voir chez [lui] une hellénisation du christianisme que la christianisation de l’hellénisme » (p. 271), et que d’autre part (et surtout) « il suffit de se reporter au Dialogue avec Tryphon pour voir que [...] la spiritualisation du sacrifice, chez notre auteur, recouvre très exactement la piété eucharistique du dernier judaïsme » (p. 273 – il convient d’entendre que « dernier » désigne ici toute l’ère postérieure à l’exil, y compris le rétablissement provisoire du culte au Temple de Jérusalem et jusqu’à aujourd’hui).
[17] HSC I, p. 49.
[18] Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique, Desclée, Tournai-Paris, 1966 (ci-après ETSPE ; 1990², Desclée-Proost, Paris, à quoi renvoient toutes les références désormais ; 2009³ au Cerf, Paris). L’ouvrage fut donc rédigé pendant le concile Vatican II, bien qu’il soit « le produit d’une vie de recherches » (p. 5). Le P. Bouyer racontait que son Eucharistie lui avait coûté quinze ans de travail et qu’on en avait vendu 1500, alors que 15000 exemplaires étaient partis de La Décomposition du catholicisme, qui lui avait pris quinze jours. Il a participé à une commission préparatoire pour les études et les séminaires et au conseil pour l’application de la réforme liturgique, mais n’ayant été entre deux appelé à Rome comme peritus par aucun évêque français après sa démission de la Faculté de Théologie de l’Institut catholique de Paris en 1962, suite à des polémiques avec les jésuites français, critiques précisément de son Histoire de la spiritualité.
[19] ETSPE, « Préface pour une réédition », p. 3.
[20] ETSPE, p. 7.
[21] HSC I, p. 45, synthétisant par avance les chapitres III et IV d’ETSPE, p. 35-93.
[22] ETSPE, p. 101.
[23] ETSPE, p. 103.
[24] ETSPE, p. 107.
[25] ETSPE, p. 105-108.
[26] ETSPE, p. 109. La « liturgie de la Parole » qui constitue la première partie de la célébration chrétienne de l’eucharistie est elle-même présentée (bien que l’objet du livre soit l’anaphore, et non l’ensemble de la messe) comme une reprise de l’office synagogal des lectures dont Luc 4, 16-30 donne un bon exemple.
[27] ETSPE, p. 30, 32.
[28] ETSPE, p. 21.
[29] HSC I, p. 8. Il s’agit de Liturgies Eastern and Western de Charles Edward Hammond (1837-1914), publié pour la première fois en 1878 par Clarendon Press à Oxford et maintes fois réédité avec la collaboration de Frank Edward Brightman (1856-1932).
[30] Dom Odo Casel (1886-1848) est cité par le P. Bouyer spécialement dans Le Rite et l’Homme, Cerf, Paris, 1962, 2009².
[31] ETSPE, p. 22.
[32] Edmund Bishop (1846-1917) est un Anglais converti au catholicisme, que sa santé empêcha de prononcer ses vœux à l’abbaye bénédictine de Downside, mais qui y laissa les livres et documents qu’il avait rassemblés sur l’histoire de la liturgie, dont fut tirée une Liturgica historica (Clarendon Press, Oxford, 1918). Le P. Bouyer, familier de Downside, put y consulter la bibliothèque d’Edmund Bishop.
[33] Anton Baumstark le Jeune (1872-1948), orientaliste allemand, est l’auteur d’un ouvrage sur le développement historique de la liturgie (1923) et d’une Liturgie comparée éditée en 1939 et rééditée en 1953 par dom Botte (voir la note suivante) à l’abbaye de Chevetogne en Belgique que le P. Bouyer a fréquentée et qui avait été fondée par dom Lambert Beauduin (1873-1960, un autre guide dans sa passion pour la liturgie). Baumstark est par ailleurs un curieux personnage : fervent nazi mais chassé de l’université sur des accusations d’homosexualité.
[34] David Hedegard (1891-1971) est un bibliste suédois auquel le P. Bouyer doit une bonne part de sa connaissance des textes liturgiques du culte synagogal au temps de Jésus.
[35] Dom Bernard Botte (1893-1980), bénédictin belge, fut apprécié par le P. Bouyer au Centre de Pastorale liturgique après la Seconde guerre mondiale, puis comme premier directeur de l’Institut supérieur de Liturgie à l’Institut catholique de Paris et enfin comme proche collaborateur pour la mise au point de la deuxième prière eucharistique lors de la réforme du missel après Vatican II.
[36] Exégète luthérien allemand, Joachim Jeremias (1900-1979) fut professeur de Nouveau Testament à Göttingen et auteur notamment de Die Abendmahlsworte Jesu (1960), dont le P. Bouyer utilisa la traduction anglaise avec les corrections apportées par l’auteur (The Eucharistic Words of Jesus, SCM Press, Londres, 1964).
[37] Dom Gregory Dix (1901-1952), bénédictin anglican, a insisté sur l’importance des « formes de la liturgie » (The Shapes of the Liturgy, Dacre Press, Londres, 1945) comme véhicules obligés de son contenu et de sa portée pour influencer dans l’Église d’Angleterre un recentrage de l’eucharistie sur la continuité de la Tradition depuis le judéo-christianisme.
[38] Max Thurian (1921-1996), pasteur suisse, membre de la communauté œcuménique de Taizé, finalement devenu catholique, auteur de L'Eucharistie. Mémorial du Seigneur. Sacrifice d'action de grâce et d'intercession, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 1959.
[39] L’Église de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit, Cerf, Paris, 1970 (ci-après ED), p. 643-648. Ce livre est le second tome (sociologie) d’une première trilogie « économique » qui comprend déjà (en tant qu’anthropologie) Le Trône de la Sagesse. Essai sur la signification du culte marial, Cerf, Paris, 1957 et qui sera achevée par Cosmos. Le monde et la gloire de Dieu, Cerf, Paris, 1982 (comme cosmologie). Une deuxième trilogie, proprement théologique, avec des volumes (tous au Cerf également) consacrés à chacune des trois personnes divines (Le Fils éternel, 1974, Le Père invisible, 1976 et Le Consolateur, 1980) aura été produite entretemps et cet opus magnum sera complété par une troisième trilogie, sur les trois notions-clés de mystère (Mysterion, François-Xavier de Guibert-O.E.I.L., Paris, 1986), de gnose (Gnosis, Cerf, Paris, 1988) et de Sagesse (Sophia, Cerf, Paris, 1988).
[40] ED, p. 644. La référence au P. Fessard (1897-1978) est De l’actualité historique, tome 1, p. 215 et suivantes (Desclée de Brouwer, Paris, 1959) et à Nostra aetate 4 (ce renvoi à la déclaration de 1965 étant vraisemblablement ajouté in extremis comme une confirmation magistérielle dans le livre publié l’année suivante, mais en gestation depuis longtemps).
[41] Jean Daniélou (1905-1974) a publié Théologie du judéo-christianisme, Desclée, Tournai, 1958 ; 1991² avec une préface de Marie-Josèphe Rondeau).
[42] Parole et Silence, Paris, 2002.
[43] Alors que les PP. Daniélou et Bouyer parlent uniquement du judéo-christianisme des apôtres à Jérusalem, l’expression « Église de la circoncision » semble due au franciscain italien de Terre sainte Bellarmino Bagatti (1905-1990), qui s’est efforcé de démontrer son existence au-delà de la destruction du Second Temple de Jérusalem, à partir non pas de textes, mais de ses fouilles archéologiques (L’Église de la circoncision, traduction d’Albert Storme d’après le manuscrit italien, Studium biblicum franciscanum, Jérusalem, 1965). Les thèses du P. Bagatti ont été contestée, notamment par Joan Taylor, Christians and the Holy Places : The Myth of Jewish-Christian Origins, Clarendon Press, Oxford, 1993). La communauté de juifs baptisés qui se réunit aux monastères bénédictins d’Abou Gosh près de Jérusalem, suite à une initiative en 1976 de dom Paul Grammont (1911-1989, abbé du Bec Hellouin), revendique néanmoins cette appellation : voir Rivka Karplus, « L’Église de la circoncision », Communio, 2008, 3, p. 103-116.
[44] ED, p. 644. Les citations sont successivement Romains 11, 2 puis 29, puis Galates 4, 5 et enfin Romains 11, 25 puis 26.
[45] Romains 11, 25.31. Notons que c’est une partie d’Israël (et non la totalité) qui « s’est endurcie ».
[46] ED, p. 648-649. Le cri de Paul se trouve en 1 Corinthiens 9, 16. Cette remarque montre que les protestants « évangéliques » américains sautent l’étape paulinienne lorsqu’au nom d’un certain millénarisme basé sur l’Apocalypse de saint Jean, ils soutiennent l’État d’Israël et même son expansion en s’imaginant que sa réussite prélude à la reconnaissance par tous les Juifs du Christ comme leur Messie. C’est plutôt la conversion de tous les « Gentils » qui est, selon saint Paul, la condition préalable du rassemblement de l’unique Peuple de Dieu agrégeant l’Église à Israël. Voir notre article : « Cet étrange sionisme évangélique », Revue théologique des Bernardins, 6 (2012).
[47] Genèse 12, 3 ; 17, 5-6.
[48] ED, p. 644.
[49] ED, p. 645.
[50] ED, p. 646.
[51] Op. cit. note 41, 1991², p. 36-37. Le P. Daniélou s’écarte ici de la thèse de l’historien strasbourgeois des religions Marcel Simon (1907-1986) : Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire romain (135-425), E. de Boccard, Paris, 1948, où l’appellation « judéo-christianisme » est réservée aux Juifs chrétiens qui continuent d’observer toutes les prescriptions de la Loi.
[52] Allusion à Actes 10-11 : premiers baptêmes de païens à Césarée par Pierre, qui se justifie ensuite devant les autres apôtres à Jérusalem.
[53] ED, p. 646.
[54] Prise de risque consciente : « Nous devons résister à la tentation de lire trop en clair ce qu’on peut considérer comme la dernière prophétie avant que vienne le temps de son accomplissement » (ED, p. 647). Mais le risque n’est pas totalement évité : on peut détecter chez le P. Bouyer, bien qu’il dise nettement que la priorité des chrétiens doit être la conversion des païens et non des Juifs (voir ci-dessus la note 45), la persistance d’une subordination, largement répandue dans l’Église depuis les polémiques des premiers siècles de l’ère chrétienne, de l’« accomplissement » total de la fin des temps à l’efficacité immédiate dans la mission d’évangélisation y compris des « frères aînés » : « S’il est un point sur lequel tous les chrétiens aient à se repentir et à se convertir, ce n’est pas seulement d’avoir cédé tant de fois à l’antisémitisme [sans doute conviendrait-il de parler plutôt d’antijudaïsme] et d’en garder encore tant de restes, mais c’est d’oublier avec tant de persévérance que l’objectif ultime de leur témoignage doit être de regagner Israël au Christ qui reste le Messie des Juifs ». Formulation redoutablement ambiguë, dans la mesure où la conversion n’est pas obtenue par le témoin seul, puisqu’il n’est jamais qu’un instrument ou un messager de Dieu, dont le dessein demeure irréductible à ce qu’il peut en concevoir et entreprendre de réaliser par ses propres moyens dans une impatience présomptueuse. Le P. Bouyer corrige d’ailleurs immédiatement en ajoutant sitôt après (et c’est la conclusion de cette section sur « L’Église et le peuple juif ») que les chrétiens sont à jamais dépendants des Juifs : « Les “Gentils” eux-mêmes ne seront vraiment tout à Lui [le Messie] que lorsqu’ils auront accepté toutes les leçons que le Peuple élu a encore à leur faire entendre » (ED, p. 648).
[55] Les écrits apocalyptiques de la Bible (Daniel 10-12, Zacharie...) sont postérieurs à l’exil, et donc d’un temps où le judaïsme est affronté à l’hellénisation. On revient ici implicitement à Philon (voir ci-dessus le passage de HSC I référencé en note 15).
[56] ED, p. 647. On a là l’affirmation que le judéo-christianisme est une réalité toujours actuelle, parce non seulement historique mais eschatologique.
[57] Hébreux 12, 23.
[58] Le sein d'Abraham est, dans le judaïsme à partir de l'époque du Second Temple, la demeure des justes entre leur mort et la résurrection finale ; voir Luc 16, 22.
[59] Jean 11, 52.
[60] ED, p. 648.
[61] Sur Origène, voir ci-dessus note 15. Saint Jérôme (vers 347-420) traduit la Bible en latin (c’est la Vulgate) à partir non seulement du grec de la Septante, mais aussi des textes hébraïques. André de Saint-Victor (mort en 1175) est membre de la célèbre école-abbaye parisienne où, fidèle à son maître Hugues (1096-1141), il enseigne que le Premier Testament doit être lu et compris dans son hebraica veritas.
[62] ED, p. 647. Le P. Bouyer a concrètement œuvré à actualiser ce ressourcement biblique d’une part dans la spiritualité chrétienne en présentant, comme on l’a vu, le judaïsme comme sa matrice, et d’autre part dans la liturgie, comme cofondateur du Centre de pastorale liturgique en 1943 (alors qu’après sa réception dans l’Église catholique, il était encore au noviciat des oratoriens et pas encore ordonné prêtre), où il insiste, parfois contre le clergé soucieux de faciliter l’accès et la participation des fidèles de culture sécularisée, sur la nécessité de la lecture de textes vétérotestamentaires (voir Le Métier de théologien, France-Empire, Paris, 1979 ; réédition Ad Solem, Genève, 2005, p. 67, 148, 274-276).
[63] Romains 11, 18.
[64] ED, p. 647.
[65] Atypique non parce que pratiquement ostracisé dans « l’hexagone » à partir de la fin des années 1960, mais parce que « touche-à-tout » ayant – soit par goût personnel, soit, de même que le P. de Lubac (1896-1991), pour suppléer sur des chaires vacantes, et non par ambition carriériste ou encyclopédique – travaillé dans des disciplines depuis cloisonnées et réservées à des auteurs de thèse dans le champ correspondant, et ayant finalement produit une œuvre probablement sans analogue en France et dont l’ampleur à la fin du XXe siècle approche celle de son ami Hans Urs von Balthasar (1905-1988).
[66] Il cite « Marc H. Tanenbaum de New York [1925-1992, que le cardinal Lustiger rencontra lui aussi là-bas en 1986 et qui fut un des premiers rabbins (de formation « orthodoxe » à la Yeshiva University) à promouvoir le rapprochement judéo-catholique à l’époque de Vatican II] et le cantor [H. Richard] Brown de Temple Beth-El [« libéral »], South Bend, Indiana [près de Notre Dame University où il enseigna régulièrement dans les années 1952-1968], lequel, non content de nous prêter généreusement les livres les plus précieux de sa propre bibliothèque, nous a aidé de son expérience du rituel synagogal » (HSC I, p. 6).
[67] Cerf, Paris, 2014, p. 83.
[68] Sur Louis (comme orthodoxe Lev, c’est-à-dire Léon) Gillet (1893-1980), voir Élisabeth Behr-Sigel, Lev Gillet, « Un moine de l’Église d’Orient », Cerf, Paris, 1993. Le livre évoqué : Communion in the Messiah. Studies in the Relationship between Judaism and Christianity, n’est paru qu’en anglais chez Redhill à Londres en 1942. Le P. Bouyer était à cette époque novice chez les oratoriens et aura sans doute pris connaissance du manuscrit lorsqu’il fréquentait l’ex-bénédictin avant la Seconde Guerre mondiale.
[69] Voir Du protestantisme à l’Église, Cerf, Paris, 1954.
[70] Voir par exemple son Introduction à la vie spirituelle, Cerf, Paris, 1960, 2008², p. 27-57.
[71] Romains 11, 24.
[72] Léon Bloy (1846-1917) a publié Le Salut par les Juifs en 1892.
[73] De Charles Péguy (1873-1914), voir Notre jeunesse, 1910 (éd. Pléiade des Œuvres en prose, 1909-1914, spécialement p. 544-553, 573-578 et 625-638, avec ce mot pénétrant : « Les antisémites ne connaissent pas les Juifs », p. 630).
[74] Le jésuite Joseph Bonsirven (1880-1958) est l’auteur entre autres de Juifs et chrétiens (Flammarion, Paris, 1936) et Les Juifs et Jésus (Beauchesne, Paris, 1937).
[75] L’épouse de Jacques Maritain (1882-1973), Raïssa (1883-1960), était d’origine juive. On peut citer la célèbre conférence de Jacques Maritain en 1938 : « Les juifs parmi les nations ».
[76] L’abbé suisse Charles Journet (1891-1875) publia Destinées d’Israël. À propos du Salut par les Juifs (Walter Egloff, Fribourg-Paris, 1945.
[77] Le jésuite Henri de Lubac (1896-1991) a notamment publié Résistance chrétienne à l’antisémitisme (Paris, Fayard, 1988).
[78] Le dominicain Yves Congar (1904-1995) a traité du Catholicisme devant la question raciale (Unesco, Paris, 1953).
[79] Fadiey Lovsky (né en 1914), historien protestant et prix 2000 de l’Amitié judéo-chrétienne de France, a écrit L’Antisémitisme chrétien (Albin Michel, Paris, 1970) et La Déchirure et l’absence (Calmann-Lévy, Paris, 1971).
[80] Le dominicain Jean-Miguel Garrigues (né en 1944), dont le P. Bouyer a préfacé un livre sur le filioque (L’Esprit qui dit « Père », Téqui, Paris, 1982, 1999²), a donné L’unique Israël de Dieu (avec, entre autres, Fadiey Lovsky, Critérion, Limoges, 1987) et Le Peuple de la première Alliance (Cerf, Paris, 2011).
[81] Voir La Promesse (ci-dessus note 42) et L’Alliance, Presses de la Renaissance, Paris, 2010.
[82] Avec en particulier sa fameuse allocution du 13 avril 1986 à la synagogue de Rome, où il a déclaré aux « frères aînés » que « la religion juive ne nous est pas “extrinsèque” mais, d’une certaine manière, elle est “intrinsèque” à notre religion », et sa prière au Mur occidental du Temple à Jérusalem le 26 mars 2000, sans parler de son amitié depuis l’enfance avec le Juif de sa ville natale Jerzy Kluger (1921-2011, voir son livre Une amitié qui a changé l’histoire, Salvator, Paris, 2013).
[83] ESTPE, p. 6.